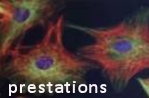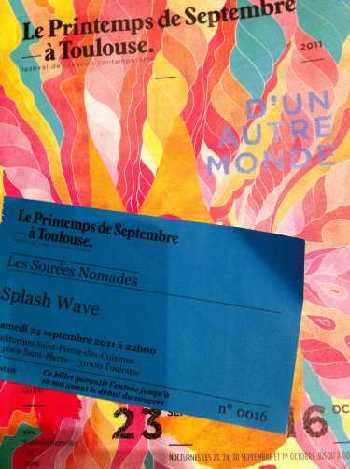|

 |
 |
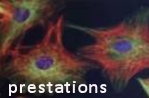 |
 |
 |
 |
Chroniques
|
La suite des Chroniques sur le blog 9Skyline...
|
|
WIC 2012
Du Rêve européen à la nouvelle donne mondiale: what's on ? |
|
Juillet 2012
10
ans, plus de 350 participants, 30 pays représentés et un
thème "Renewing growth" sur fond de "European Dream" à
réinventer...
L'édition 2012 de la World Investment Conference qui se tient
tous les ans à La Baule plaçait haut la barre des
intentions et des ambitions.
Flash-back et propos choisis ! |

|
|
Croissance, où es tu ?
Ce n’est pas parce que la WIC a pour cadre
l’immense plage de sable fin de la baie de La Baule et le décor au charme
suranné de l’Hermitage qu’on ne se pose pas de graves questions, à l’heure de
la crise de la dette, de l’incertitude financière et économique et des
changements d’états-majors dans quelques pays ayant pignon sur rue ! Sujet
du jour : Renouer avec la croissance. La belle affaire ! Chômage en
hausse, liens plus ou moins révélés entre crise et corruption, Euro ou pas
Euro, une roadmap européenne peu lisible, une logique économique parfois
oubliée et une nouvelle donne géo-économico-politique planétaire à intégrer…
Conclusion préliminaire : on est tous dans le même bateau et il est temps
de se mettre au travail et d’arrêter de se lamenter et de crier au désastre (un
travers typiquement européen) ! Pour renouer avec la croissance, cqfd.
Comment ? En mélangeant les ingrédients clefs que sont la R&D et
l’innovation, en investissant dans l’avenir et en soutenant les PME, futurs
champions du monde ou de leur marché de niche, peu importe. D’ailleurs, à la
question « From where will Europe recove attractiveness?”, les
participants de la WIC ne se trompent pas et 37.9% d’entre eux désignent les
entrepreneurs, d’ici et d’ailleurs, comme les garants d’un monde économiquement
meilleur.
Innover, créer, produire, penser différemment
Thinking out of the box ! On l’a dit et répété,
les innovations de rupture viennent souvent du croisement des disciplines, de
réflexions transversales, des interactions culturelles. Mais il ne faut pas
oublier que « l’innovation est un processus par lequel une idée se
transforme en produit ou en service pour lequel les gens vont
payer » ! Une idée, un marché ?! Le tout dans la flexibilité, la
réactivité et avec compétitivité ! Et c’est là que l’Europe peut mieux
faire et apprendre à saisir les opportunités ! Si les secteurs à la mode
(biotech, nanotech, cleantech, iTech…) et si les stratégies (clusters, crédits
d’impôts, promotion des partenariats public-privé…) se suivent et se
ressemblent à travers le monde (développé), le besoin d’harmonisation et de
simplification reste intact, couplé à la nécessité d’apprendre à surfer sur ses
atouts intrinsèques, notamment au niveau régional avec l’approche de smart
specialisation. Going back to the roots ! Pour l’Europe, la santé apparaît
ainsi comme un secteur de choix dans lequel l’héritage scientifique et
industriel et la notion d’interface entre soin, prévention, alimentation,
technologies innovantes peuvent permettre à l’Europe de (re)affirmer son
leadership, d’autant plus que le marché, population vieillissante oblige,
explose ! Mais le cocktail magique de la compétitivité n’est pas si
simple. S’il faut chercher et innover plus vite et plus intelligemment, il faut
aussi produire différemment, limiter les freins institutionnels, faciliter la
mobilité sociale et l’expression des talents, écouter les besoins des employés,
des clients, des consommateurs, des marchés extérieurs. Oui, la 3e
révolution industrielle sera à l’image du Wifi, sans frontières, a dit Jeremy
Rifkin, guest star de la WIC 2012 ! Oui, le monde est réellement devenu
global et intégré ! Et 55% des participants de la WIC 2012 estiment que
l’Europe n’est pas assez innovante pour rester la première puissance économique
mondiale !
Une Europe à
réinventer dans un monde globalisé
En
effet, si l’on considère les deux principaux moteurs de croissance,
l’innovation et la démographie, l’Europe ne tient la route dans aucun des deux.
Et a perdu ses idéaux ! Construite sur l’idée de paix, de prospérité et
d’identité européenne, la belle Europe, à peine soixantenaire, se morfond sur
fond de crise de l’Euro, d’interrogations sur ses frontières, de difficultés à
trouver des consensus à 27 et de pessimisme latent ! Pour lui redonner son
aura de grande et belle idée, il faudrait commencer par cesser de se voir comme
un musée et finir le travail commencé sans s’arrêter en (bon) chemin, affirment
les Australiens ou Indiens présents à La Baule ! Comment se réinventer et
proposer un nouveau « rêve européen » ? En revenant à ses fondamentaux :
l’Europe est la contrée qui lève les frontières, est ouverte sur l’extérieur et
unie à l’intérieur. Cela commence, à l’image de ce qui a été fait il y a
quelques décennies avec la culture américaine, par la compréhension de
nouvelles formes de pensées et notamment celles de la culture asiatique et
chinoise en particulier, dont le spectre de future potentielle première
puissance économique mondiale planait sur la WIC. 700 millions de chinois, et
moi et moi et moi ! Pourtant l’Europe reste le premier marché mondial
riche de son demi-milliard de consommateurs éduqués et au fort pouvoir d’achat
et a attiré en 2011 plus de 3900 projets d’investissements étrangers, comme
l’indique l’incontournable European Attractiveness Survey présentée chaque
année en avant-première par Ernst & Young à La Baule.
Morale
de l’histoire ? L’Europe reste incontournable et unique dans son histoire,
son concept, sa culture mais doit apprendre à mieux se vendre et à plonger dans
le grand bain d’un monde nouveau.
« Si
vous êtes dans une piscine dans laquelle se trouve un alligator, la solution
n’est pas de nager plus vite que l’alligator mais de nager plus vite que les
autres nageurs ! » Il n’y a pas de crocodilien ni de requin dans la
baie de La Baule, mais tel est en substance le conseil d’ami délivré par un des
conférenciers de la WIC, à bon entendeur…
|
|
Invention, Innovation and so on...
7e édition du Prix de l'OEB des Inventeurs Européens de l'Année
|
|
|
Juin 2012
Munich,
Ljubljana, Prague, Madrid, Budapest, Copenhague…
Sur
la trace des Inventeurs
Européens, à l’occasion de
l’événement très côté
organisé chaque année dans une
capitale européenne par l’Office Européen des
Brevets et qui se déroulait, pour sa 7e édition, le 14 juin 2012 à Copenhague.
Printemps après
printemps, sous les voûtes historiques de l’imposant Château de Prague, sur un
bateau voguant sur le Danube, sur les quais de Copenhague, on y célèbre
l’innovation créatrice de valeur et de progrès et, surtout, les inventeurs, les
histoires d’hommes (et de, rares, femmes), les aventures entrepreneuriales, les
idées géniales, les révolutions technologiques ou les hasards bienheureux.
Et des
belles histoires, des grands succès, et surtout, des grands progrès, notamment
médicaux, il y en a.
|
|

|
|
Comprendre
l’auto-immunité, soigner maladies infectieuses et cancers, réparer la vision ou
l’audition : all we need is health
En
2007, c’était Marc Feldmann qui était sacré
pour « l’œuvre d’une
vie » consacrée à l’immunobiologie et
marquée par la découverte du rôle
des cytokines dans les processus auto-immuns, à la base
d’un brevet et d’un
traitement majeur contre l’arthrite rhumatoïde. Si
l’évocation du CMH et de
TNF& avait alors réveillé des souvenirs pas si
lointains de ma thèse,
l’interview avec Marc Feldmann révéla surtout une
grande modestie et une non
moins grande passion et conviction au service de la recherche
translationnelle
(déjà très à la mode) et de la
médecine. Co-nominé moins chanceux, Alec
Jeffreys, célèbre inventeur des empreintes
génétiques, était également de la
partie cette année là. Très orientée sur la
santé et la mobilité, l’édition
2008, organisée dans la charmante capitale slovène,
avait, au cours d’une
mémorable « Inventor’s Night »,
célébré, parmi d’autres, le belge
Erik de Clercq, pour ses recherches en virologie et thérapie
antivirale, et
notamment le développement du traitement combiné de
référence contre le Sida. Santé
toujours, mais en pleine crise, l’énergie devient
omniprésente dans les
palmarès et les préoccupations, 2009 fut
l’année des « grandes
causes », en Occident avec le médicament Glivec qui a
révolutionné le
traitement de la leucémie myéloïde chronique, et
dans les pays en
développement, un traitement commercialisé par Novartis
et inventé par un
chinois contre le paludisme. Si son nom n’est pas connu du grand
public, le
Français et bien nommé Joseph Le Mer, inventeur
français d'un échangeur de
chaleur énergie-efficient et passionné de voile dans ses
moments libres, est
pourtant bien présent chez nombreux d’entre nous et
restera un grand moment
d’interview !
Et
la cuvée 2012 ? Santé, énergie, télécommunications ! Avancées
technologiques, priorités sociétales, opportunités de l’économie de la
connaissance, seule issue à la crise qui n’en finit pas : tout est là. Les
inventeurs, australiens, du Wifi, ont donc été récompensés dans la catégorie
« Non européens », nul n’est besoin de s’interroger sur l’impact
économique de cette invention, quasi révolution. Dans la catégorie PME, c’est
un dynamique tandem allemand (et un peu français) qui été jugé le plus puissant
avec sa pile à combustible portable à base de méthanol
appelée Smart Fuel Cell. Même si le
chausseur italien Geox, nominé pour son innovation futée, représentait un beau
challenger issu d’un secteur moins high-tech que d’habitude, c’est la santé qui
a raflé la mise : le Marseillais Gilles Gosselin pour ses travaux sur
l’hépatite B concrétisé par la création de la start-up qui n’en plus vraiment
une, Idenix, l’Allemand Josef Bille qui a révolutionné les techniques d’ophtalmologie
et de chirurgie oculaire grâce au laser et enfin le groupe familial et fier de
l’être, Widex, leader de la prothèse auditive sur-mesure (dont le siège social,
centre de R&D et production dans les alentours de Copenhague est une
merveille d’architecture éco-efficiente et hautement qualitative). Nous pouvons
donc vieillir en paix, la recherche avance, les idées foisonnent et l’industrie
de la santé (pharma, biotech et matériel médical) reste un exemple de secteur
où on a très vite compris qu’il fallait sans cesse innover (les chiffres des
dépenses de R&D des grands et petits du secteur en témoignent), collaborer
(la recherche partenariale et le out-licencing, de gré ou de force, sont
devenus la règle chez les big pharmas), breveter (le secteur, avec près de
19000 soumissions en 2011 est de loin le plus important en nombre de brevets
soumis chaque année à l’OEB).
Vous
avez dit « unitaire » ?
244000
demandes et 62100 brevets accordés en 2011, année record, une réputation de
brevets « qualitatifs » et juridiquement solides, l’OEB, qui se situe
parmi les premiers organismes de propriété industrielle au monde, est le bras
armé de l’Union Européenne en matière de PI et au-delà, un acteur pour
optimiser les conditions d’innovation en Europe. En 2007, lors de ma première
participation et alors que l’OEB fêtait ses 30 ans, on imaginait le futur du
brevet (ou le brevet du futur) en 4 scénarios, au gré de la loi du marché
omniprésente, de la globalisation massive, de la connaissance partagée ou d’une
dualisation entre secteurs traditionnels et high-tech. Et on attendait la
signature du protocole de Londres et l’émergence d’un véritable brevet communautaire.
En 2012, on traduit désormais les brevets grâce à Google mais on attend
toujours le feu vert pour lancer ce Graal de la PI et de l’Union Européenne dont
on discute depuis 1975… Entre temps rebaptisé « unitaire », le brevet
de l’Union Européenne a été mis en œuvre en 2011 sous les auspices de la
« coopération forcée » entre 25 pays membres. Son entrée en vigueur,
sous réserve d’accord sur le choix de la ville (Paris, Londres, Munich, et peut-être
même Milan, sont en lice, verdict annoncé pour fin juin) abritant l’instance de
règlement des litiges, est toujours pour 2014 avec à la clef la promesse de 70%
d’économie sur le coût de dépôt d’un brevet. Bref, rien de très neuf sous le
soleil (voilé) de Copenhague en ce mois de juin 2012 mais une nouvelle belle
occasion de célébrer l’innovation, les inventeurs, la créativité, la
compétitivité… And so on…
|
|
30 ans, le bel âge...
FIV, AMP, bioéthique et société: où en est-on ?
Février 2012
Amandine,
premier “bébé-éprouvette”
français a 30 ans aujourd’hui et son aînée
d’éprouvette, Louise Browns, née au Royaume-Uni, en
aura bientôt 34. Le Pr Robert Edwards, inventeur de la FIV
(Fécondation In Vitro), a eu le prix Nobel de Médecine en
2010. Mais, quelques trois décennies plus tard, où en est
on ? La France, pays pionnier en son temps dans ce domaine, a pris du
retard, prend du retard. Pour imager, on pourrait dire bloquée
au stade « 4 cellules » (l’état minimal requis
pour transférer un embryon conçu par FIV, qui se
développera ensuite in utero en 8 cellules puis en morula et
ainsi de suite avant de s’implanter définitivement et de
se transformer en foetus… ou pas car la nature est
imprévisible et souvent cruelle) !
Lois trop contraignantes, recul scientifique et technologique, fardeau
culturel, idéologies rétrogrades trop prégnantes ?
Pourquoi tournons nous en rond dans l’éprouvette en
matière d’assistance médicale à la
procréation à l’heure où
l’infertilité devient un réel souci de santé
publique ?
Deux
études publiées récemment par l’InVS
(Institut National de Veille sanitaire) révèlent
l’importance de ce thème trop peu médiatisé
et trop peu connu des décideurs et du grand public. En 2008,
121515 cycles de traitement contre l’infertilité ont
été réalisés en France toutes techniques
confondues (inséminations, FIV, dons) conduisant à la
naissance de 20136 enfants (on appréciera au passage le taux de
succès de 14.7% en nombre de grossesses à terme), qui
représentent 2,4% des naissances de l’année. Et on
estime aujourd’hui qu’environ un couple sur 4 à 6
qui arrête d’utiliser un moyen de contraception sera
concerné par une infécondité involontaire
d’un an. Le phénomène n’est donc nullement
marginal et les données épidémiologiques ne
montrent pas une amélioration, bien au contraire.
|
|
Où
en est la science ? Elle n’avance plus, ou plus aussi vite. Parce
qu’après le saut technologique au doux nom d’ICSI
(Intra Cytoplasmic Sperm Injection qui permet de féconder
directement un ovocyte par un spermatozoïde
sélectionné et optimise les chances de créer un
embryon en cas d’infertilité masculine) en 1992, on bute
désormais, notamment, sur des phénomènes mal
connus concernant la nidation et le développement embryonnaire.
Mais ce n’est pas seulement et malheureusement pas
l’état des connaissances qui freine le progrès,
c’est essentiellement la législation qui empêche
d’avancer. Car si les taux de succès des FIV stagnent en
France (il faut savoir que moins d’un couple sur 2
concrétise son projet parental et ce, malgré et au bout
de, parfois, plusieurs années de traitements), c’est
notamment parce que la recherche sur l’embryon y est interdite
(sauf dérogations), ce qui limite l’acquisition des
connaissances et la compréhension des processus biologiques que
l’on pourrait ensuite tenter de mimer in vitro ou ex vivo. Une
technique récemment mise au point de vitrification
(congélation rapide) précieuse pour conserver les
embryons (surnuméraires obtenus lors d’un cycle de
stimulation et conservés pour une implantation ultérieure
en cas d’échec) ou les ovocytes (pour les femmes devant
par exemple subir une chimiothérapie et souhaitant conserver
leur capacité à procréer après traitement)
existe et permet d’augmenter significativement les chances de
grossesse. Mais elle n’est adoptée et utilisée que peu à peu
en France et au bon-vouloir des centres AMP… Principe de précaution, résistance
au changement et au progrés ? … On constate aussi dans notre beau pays un
sous-équipement technique chronique : les gamètes
récoltées et les embryons mis en culture doivent
être précieusement surveillés et incubés
à température strictement constante mais les centres
français ont peu d’incubateurs, qui servent pour beaucoup
de couples et sont donc ouverts et rouverts à chaque
manipulation, quelques degrés et variations à la clef
à chaque fois. Une imparable « sélection naturelle
» mais surtout une grande perte de chances…
Où en est la société sur ces questions ? Les
débats vains se succèdent, mettant trop souvent en avant
ceux qui ne sont pas concernés et prônent un dogmatisme
hors d’âge. Le sujet des « mères porteuses
» en est un bon exemple. Cela concerne-t-il seulement quelques
stars et starlettes hollywoodiennes qui veulent pouvoir dégainer
(et rentrer) dans leur fourreau red carpet à tout moment ?
Certainement pas et alors que, malgré les récentes
tentatives de greffe d’utérus et des travaux restés
inaboutis sur l’utérus artificiel, la science ne sait pas
(encore ?) répondre à ces problèmes là, on
refuse à celles qui sont concernées une
opportunité d’avoir un enfant issu du couple mais
porté, dans un geste qui n’est pas anodin mais qui est
surtout altruiste, par une autre. La question de la gratuité,
qui se pose également dans le cas du don (de gamètes
notamment) est ici posée. Pourquoi s’arc-bouter sur ce
principe de la gratuité (et de l’anonymat du don) ?
Hypocrite et naïf, ce principe est fortement inégalitaire :
rappelons qu’il n’y a pas d’égalité en
matière de procréation entre « fertiles » et
malchanceux « infertiles » et que les couples infertiles doivent
montrer patte blanche et certificat de mariage avant d’être
acceptés en centre AMP et qu’ils ont 4 chances
remboursés par la Sécurité sociale quand les
autres en ont… tous les mois ! Il est surtout injuste et, face
aux listes d’attente en France (plusieurs années pour un
don d’ovocytes), cela conduit à d’autres dérives
pourtant décriées, celui de la recherche de donneurs
à l’étranger et du tourisme procréatif.
Quand on connaît la lourdeur d’un protocole de stimulation ovarienne, est il raisonnable de ne pas envisager un
dédommagement pour les préjudices physiques subis,
à l’image de ce qui se fait en Espagne, pays pourtant
très catholique mais beaucoup plus en avance sur ces questions
là que la France. Si l’hypocrisie est latente, il y a
aussi pas mal d’ironie au détour du chemin : en novembre
2011, l’Agence de Biomédecine lançait une grande
campagne en faveur du don de gamètes, visant le recrutement de
donneurs (les conditions stipulent que les donneurs doivent être
eux-mêmes parents, et âgées de moins de 37 ans pour
les femmes). Mais c’est, bizarrement, dans les centres AMP que
l’on voit ces affiches ! Ne serait ce pas plutôt dans les
maternités qu’il faudrait placarder ces appels à la
solidarité, pour sensibiliser ceux qui ont naturellement la
chance et les capacités physiques à avoir un enfant?
Cachez ce mal que je ne saurais voir : à l’heure de la
glorification à tout va de la parentalité de tout type,
l’infertilité serait-elle un nouveau tabou social ?
Autre mystère, qui se situe sans doute à mi-chemin entre
le culturel, le philosophique et le scientifique, comment expliquer
que, dans nos sociétés développées
où l’on parle tant d’égalité entre les
sexes, quand c’est l’homme qui est infertile, on traite,
uniquement et massivement, la femme, fut-elle, elle, tout à fait
fertile ?! On a donc su mener et conclure des recherches sur les
difficultés érectiles mais pas sur les problèmes
d’infertilité masculine ? Pourquoi le marché
pharmaceutique regorge-t-il de petites pilules bleues et n’y
a-t-il pas un seul médicament permettant de traiter
l’infertilité à sa source quand elle provient de
l’homme, soit un cas sur deux environ chez les couples
concernés ? Les chiffres rappelés plus haut sont sans
appel, ce n’est pas une question de marché de niche non
rentable et de pathologie orpheline… Alors, misogynie ambiante,
suprématie masculine (notamment dans le milieu médical),
(faux) culte de la virilité, distorsion culturelle
héritée, notamment, de sarcastiques injonctions
religieuses qui pèsent sans doute sur nos mentalités
judéo-chrétiennes ? Il faut noter ici que la toujours
très en avance religion catholique à la morale pourtant
souvent discutable est la seule des grandes religions à refuser
et condamner l’assistance médicale à la
procréation… On en pense ce qu’on veut mais ce
fardeau culturel-sociétal-religieux aura sans doute pesé
sur les non-avancées des débats lors de la
révision de la loi de bioéthique.
Car, au fait, où en est donc la loi ? 1994, 2004, 2011 : la Loi
de Bioéthique en France est un peu un long fleuve tranquille et
paresseux. Dans la torpeur de l’été et avec trois
ans de retard (la loi de 2004 devait être révisée
initialement en 2008…), il n’y a pas eu de
révolution en juillet 2011, même si quelques espoirs
étaient nés en première lecture au Sénat,
pour une fois, plus avant-gardiste ou du moins en phase avec la
réalité. Après de vaines avancées vers une
« autorisation avec restrictions », on est revenu vers
« l’interdiction avec dérogations » : la
nuance est subtile mais implacable et la recherche sur l’embryon
reste donc interdite en France. Idem pour la gestation pour autrui et
les assouplissements en matière de dons de gamètes :
statu quo. Est-ce à relier au fait que les députés
et sénateurs sont majoritairement des hommes d’âge
mûr (ne vexons personne), tout comme d’ailleurs quelques
grands mandarins en centres d’AMP pour lesquels la lourdeur,
physique et morale, des protocoles semblent être un mythe…
?! Si on ne peut que déplorer l’attentisme,
l’indifférence et les combats
d’arrière-garde, il reste que les opportunités (et
les évolutions à venir) en matière d’AMP
doivent rester strictement encadrées, qu’il s’agisse
de la gestation pour autrui, des mesures incitatives au don
d’ovocytes et surtout en premier lieu de l’accès
à l’AMP (et son remboursement, la France étant un
des rares pays où la Sécurité sociale rembourse 4
tentatives par couple) qui doit rester strictement
réservé à l’infertilité
médicale et non à une infertilité sociale ou
à des convenances personnelles. Ce qui n’empêche pas
la loi et la société de s’adapter et la
science d’avancer. Bon anniversaire Amandine !
|
|
Communicating the Bioeconomy: un challenge européen
Février 2012
« Communicating the Bioeconomy »: à
une semaine de la publication de la nouvelle stratégie de l’Union Européenne en
matière de bioéconomie, le workshop organisé le 7 février à Bruxelles par la DG
Recherche et Innovation était d’actualité. Et ne pouvait manquer de m’attirer,
la communication autour des biotechnologies et de la bioéconomie étant le cœur
de l’engagement et de l’activité de VICBIOSTART depuis plus de 10 ans.
|
Dans
un Bruxelles blanchi par la neige, une cinquantaine de scientifiques,
journalistes, consultants, représentants de projets et d’institutions
européennes avait donc la mission et l’ambition d’échanger et de s’informer sur
les enjeux, les pratiques et les « tips » pour mieux communiquer, voire
vulgariser, ce secteur encore mal connu et mal compris du grand public (et pas
seulement sans doute !).
Pourtant
à l’heure de l’Europe 2020, la bioéconomie a tout bon côté « smart
growth » et « green growth ». Mêlant dans un même élan
prometteur science et industrie, recherche fondamentale et appliquée,
innovation et transfert de technologie, elle incarne à merveille cette fameuse
« économie de la connaissance », éternel cheval de bataille de
l’Europe. En première ligne pour inventer les nouvelles sources d’énergies
renouvelables, exploiter la biomassse et les vaillants micro-organismes aux
ressources et propriétés insoupçonnées, et mettre au point les technologies
pour fabriquer « propre » et durable, elle est aussi une belle
illustration de cette croissance qui sera demain verte et belle sur la planète
Terre. Cerise sur le gâteau : les biotechnologies, rouges, vertes,
blanches, mais aussi jaunes, noires, mauves et bleues, sont à même de
contribuer à répondre aux grands enjeux de demain : « food, feed, fuel,
fiber, health », autrement dit et entre autres, nourrir et soigner une
population sans cesse croissante et encore plus vieillissante et fournir de
l’énergie et du carbone dans un environnement sain à nos sociétés toujours plus
consommatrices faute d’être de plus en plus développées.
|
|

|
|
Pourtant
même si les biotechnologies et la bioéconomie sont déjà omniprésentes dans
notre quotidien (des poches en maïs du supermarché aux bouteilles de soda
recyclables, des vaccins aux traitements hormonaux, des aliments en 3 lettres
si tabous mais pourtant tant consommés aux voitures roulant au bioéthanol, 2e
génération s’il vous plait), elles restent auréolées d’un grand mystère et
révèlent un gros complexe d’infériorité face aux secteurs industriels durs,
purs et reconnus (prenons l’exemple de Toulouse dont le géant avion cache les,
par effet de ricochet, peu visibles biomédicaments ou aliments sous label de
qualité !) et un complexe de… complexité. Complexe la bioéconomie ?
Oui et à double titre. Transversales dans leurs applications et
multidisciplinaires dans leurs fondamentaux scientifiques, les biotechnologies
font appel aux sciences du vivant (vaste domaine s’il en est) mais aussi à la
médecine, à la chimie, aux matériaux, et flirtent aussi parfois avec les
nanotechnologies et relèvent donc d’une compréhension fine et
multidisciplinaire d’approches et de théories scientifiques diverses. Elles
portent aussi une complexité structurelle, liée à la diversité des acteurs
impliqués (laboratoires de recherche, start-up, PME, grands groupes mais aussi
agriculteurs, associations de patients ou de consommateurs, institutionnels,
agences de régulation…), à une montée en puissance des collaborations et des
partenariats (notamment public-privé) et à la notion très spécifique de « chaîne
de valeur » (les fameux « from farm to fork », « from
stable to table », « from bed to benchside »… La liste n’est pas
exhaustive). On peut aussi rajouter une couche de « cluster », les
biorégions ayant aussi fleuri au fil des années en Europe, des historiques
Medicon Valley ou Triangle Oxford London Cambridge aux plus récents pôles de
compétitivité français tel Cancer-Bio-Santé.
Complexes
donc, difficilement compréhensibles par le commun des mortels (et des
gouvernements qui multiplient pourtant depuis des années des
« blueprint », « white paper » et autres plans d’action plaçant
les biotechnologies au cœur des stratégies et priorités scientifiques et
économiques…) et nécessitant donc un effort et une attention de
« communication » si l’on veut éviter les malentendus et les
réactions négatives teintées de résistance au changement comme pour les OGM.
OGM dont on oublie aussi qu’ils permettent, grâce à des variétés optimisées,
d’utiliser moins de pesticides et moins d’eau, mais c’est un autre débat !
A Bruxelles ce 7 février, on a aussi évoqué le système de santé publique (qui
est de fait un « illness system » plutôt qu’un « health
system », la prise en charge et l’activité économique liée étant associées
à la gestion de maladies et de malades plutôt qu’à la (bonne) santé. A qui
profite le crime et pourquoi nos approches médicales sont elles aussi curatives
et si peu préventives ?! Question de culture sans doute (nous ne sommes
pas en Chine) mais pas seulement. Pourtant à l’heure du vieillissement de la population
et des statistiques indiquant qu’un tiers de la population devrait être touchée
au cours de sa vie par un cancer, suivi ensuite d’une quelconque dégénérescence
neurologique liée à l’âge, on peut légitimement s’inquiéter de la
« sustainability » de nos systèmes de santé publique…. Mais c’est là
encore un autre débat ! A Bruxelles, on a aussi parlé du « cycle
d’innovation en biotech » et du financement de la bioéconomie, secteur à
ROI lent quand un biomédicament nécessite des années de recherche avec un
« attrition rate » élevé et des tonnes de paperasses pour obtenir une
AMM (le fameux regulatory burden qui pénalise tant les entreprises innovantes
aux prises avec les législations nationales, communautaires et internationales)
avant de dire adieu, à peine 20 ans après, à l’exclusivité de son brevet. Le
brevet européen ? Non c’est un autre débat ! Mais à propos de brevet,
si l’Europe tient la corde avec les Etats-Unis en termes de publications, elle
décroche quand on parle de brevet et donc de transfert et donc de
transformation (de l’essai) : la route « de l’idée au marché »,
des connaissances au produit, est longue en vieille Europe, et sans doute en
particulier en France ! Ne parlons pas de l’Asie, qui avance très vite et
ne s’est pas contenté de rester l’usine du monde…
Bref,
la bioéconomie est partout même si personne ne le sait et ne le voit –ne veut
le voir- et demain, nous soignera des maladies les plus chroniques et
incurables à ce jour, nous permettra de nourrir les 7 milliards d’humains (et plus
demain) qui peuple la Terre tout en continuant à se chauffer, s’éclairer, se
déplacer et nous apportera en plus emplois et valeur ajoutée !
Eureka ! Si la bioéconomie n’était pas là, il faudrait l’inventer ! Alors
Europe 2020, Lead Market Initiative, KBBE (pour les non-initiés :
Knowledge-based BioEconomy), en attendant la version 2012 de la stratégie
européenne qui lancera peut-être enfin une véritable
« biorévolution » : communiquons ! Et avançons dans le(s)
débat(s) tout en permettant aux acteurs du secteur de faire progresser les
connaissances sur le vivant,
de breveter, de publier, de sortir des produits sur le marché, en un mot, d’INNOVER !
|
|
|
|
|
|
|
2012, tracer l'avenir de tous les possibles
Janvier 2012
2012
: Une année placée sous le signe de l’audace, du
courage, du changement, et sur les traces du bonheur, du succès,
de la sérénité et de l’épanouissement
des idées et des projets. « Tracer l’avenir de tous les possibles
» est, en ce début d’année, une
détermination personnelle et le slogan de VICBIOSTART en
souhaitant à chacun, sur fond de ciel bleu, de suivre son propre
chemin vers un horizon prometteur.
Si
l’année est nouvelle, 2012 reste la suite logique de 2011.
Et les idées neuves et révolutions de pensée
restent rares quel que soit le microcosme dans lequel on évolue
! Alors qu’Europe 2020, suite à la défunte
Stratégie de Lisbonne, place la R&D&I (recherche,
développement, innovation), le changement climatique et
l’énergie, mais aussi l’emploi,
l’éducation et l’exclusion sociale parmi ses
priorités, la créativité, l’innovation,
l’économie de la connaissance et sa consoeur la croissance
intelligente, l’internationalisation, le développement
durable sont toujours les facteurs clefs de réussite. Mais
l’époque remet donc aussi au centre du jeu et des enjeux
l’être humain, l’éthique et
l’authenticité, qu’il s’agisse de
l’avènement de la médecine personnalisée, de
la quête de naturalité en matière
d’alimentation ou de la (très lente) progression du droit
face aux progrès scientifiques et aux évolutions
sociétales.
|
|

|
2012
commence donc comme a fini 2011 : sans neige mais sous le signe du
blanc ! La tendance « color block » étant
(heureusement) passée, c’est au tour des livres blancs et
autres recommandations de fleurir, sans attendre les hirondelles, mais
justement en prévision du printemps et de ses
échéances politico-stratégiques.
Dans
la sphère de l’entreprenariat et de l’innovation, le
Livre Blanc du Comité Richelieu et les Recommandations de
l’Académie des Technologies s’intéressaient
dès mi décembre au financement des entreprises
innovantes, notamment dans le domaine, toujours aussi mal aimé
des investisseurs, des biotechnologies et du drug discovery. On
constatait alors la fin du modèle de financement des
années 90 et on avançait une série de propositions
« pour faire des PME innovantes des champions de la croissance et
de l’emploi », en soutenant l’innovation et en
accompagnant la création et le développement
d’entreprises performantes.Et en optant notamment pour la
sélectivité, car, si la sélection naturelle
fonctionne très bien en temps de crise, autant ne pas gaspiller
les moyens (limités toujours à cause de ladite crise),
éviter le saupoudrage et ne choisir que l’excellence !
Toujours d’actualité aussi, l’accès pour les
PME à la commande publique incarné par le très
américain Small Business Act dont le petit frère
européen est encore au stade embryonnaire. Hommage soit rendu en
passant au Dr Edwards, Prix Nobel de Médecine 2010, mais dont le
génie ne s’étend malheureusement pas à la
fécondation de toutes les bonnes idées. L’argent
restant, ici comme ailleurs, souvent le nerf de la guerre,
comités, académies et autres experts réclament
depuis des mois (des années ?) le renforcement du système
de capital risque et notamment celui de l’amorçage early
stage. D’un « equity gap » à l’autre et
parce que la notion de proximité est remise à
l’honneur, le Fonds Stratégique d’Investissement
(FSI) Régions s’est déployé début
janvier, avec pour mission de renforcer les fonds propres des PME
jusqu’au fin fond des provinces ! Car, même ou surtout
à l’ère de la mondialisation, « territoire
» n’est plus un vain mot et « si vous voulez
créer une entreprise, la localisation compte »,
précise l’OCDE, qui, données à
l’appui, détaille les pays où il fait bon faire du
business. Si l’esprit d’entreprise et la culture de
l’entreprenariat (et la légèreté
administrative) ne sont malheureusement pas les qualités les
plus répandues au pays des fromages, des classements datant de
1855 et des climats depuis longtemps protégés, il restera
toujours un certain art de vivre, un certain talent pour
l’excellence (scientifique notamment), un certain esprit à
la française hérité des heures de gloire
passées sur lesquelles il faudrait peut-être aussi cesser
de se reposer. Même si on peut s’énorgueillir
d’avoir « inventé », il y a quelques trois
siècles, l’industrie du luxe, vrai fleuron de
compétitivité et de notoriété. Un secteur
qui, comme dans l’œnologie, manie si bien tradition et
innovation et où comme ailleurs, le mot d'ordre
est: création / créativité! Dans un
registre différent, alors que la communauté scientifique
célèbre cette année les 200 ans d’un journal
médical à fort facteur d’impact, le très
bostonien New England Journal of Medicine né au cœur de ce
qui allait devenir l’un des bioclusters de
référence au niveau mondial, on peut se réjouir
des avancées scientifiques et médicales qui ont
alimenté les derniers siècles et surtout
décennies. Car il paraît qu’en à peine un peu
plus de 10 ans, nous avons acquis plus de connaissances que ce qui
avait été appris depuis l’origine des temps
jusqu’à la fin du XXe siècle !
La
boucle est bouclée pour, de la science au vin en passant par
l’économie et l’art, placer l’année
2012 sous le signe de la créativité et de la
pugnacité !
|
Arty Fall
Dans l'art du temps...
Novembre 2011
Printemps
de Septembre, Collector Tri Postal, FIAC: 3 villes, Toulouse, Lille, Paris, et
3 approches et visions de l'art contemporain.
|
A
Toulouse, le Printemps de Septembre, né cadurcien il y a 21 ans,
propose chaque automne un festival éclectique, mêlant
expressions artistiques (de la photo historiquement à une 20e
édition dédiée à la performance) et se
voulant ouvert au public et sur la ville. Moins énigmatique que
les précédentes « Là où je suis
n’existe pas », ou « Là où je vais
je suis déjà » (2008, 2009), le Printemps 2011 se
voulait, sous la direction d’une nouvelle commissaire, Anne
Pontégnie, « d’un autre monde ». Pendant 3
semaines, du 23 septembre au 16 octobre, le festival présentait,
à Toulouse et alentours, une vingtaine d’expositions et
une cinquantaine d’artistes, associés à des
Soirées Nomades (mention spéciale au sympathique Splash
Wave), des Apéros du Bout de la Nuit et à un parcours
lumière dans la ville rose. Tout un programme au cours duquel on
a pu découvrir un géant totémique au cœur de
l’ancien prieuré des Chevaliers de Saint-Jean ou des
gargouilles post-modernes aux Augustins signés Thomas Houseago,
tenter de comprendre la danse Butô ou le théâtre No
grâce à Tatsumi Hijikata et Simon Starling dans
l’ancien couvent gothique des Jacobins. Au Château
d’Eau, en écho à l’architecture ronde et
technique du lieu, Ei Arakawa échafaude une théorie de
séparation d’algues dans son gel (acrylamide ?) «
See weeds ». 15 artistes plus loin aux Abattoirs, on retraverse
la Garonne pour écouter les musiques florales de la belge Edith
Dekyndt sur fond d’acides aminés et d’ondes
invisibles. Poétique. Après la référence
pseudo-scientifique, place à l’Histoire, ou plutôt
la Préhistoire avec « Grotta Profunda ou les Humeurs du
gouffre » de Pauline Curnier-Jardin à Niaux. Pas de choc
visuel ou conceptuel pourtant en ce Printemps de Septembre 2011. Il
n’y a plus de saison… Vivement 2012 !
|
|
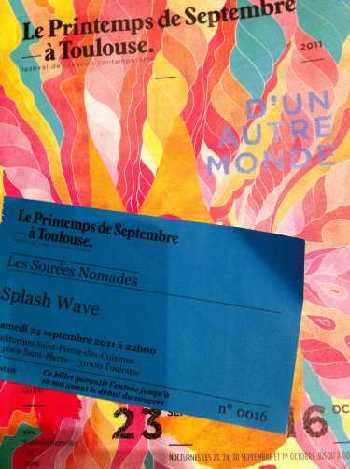
|
A
Lille, il semblerait que la saison bat son plein depuis 2004 et la
bienvenue consécration comme Capitale Européenne de la
Culture. En cet automne 2011, l’exposition Collector propose une
rétrospective impertinente (et quelques valeurs sûres)
à travers un panorama admiratif des 220 ans de collection du
Centre National des Arts Plastiques. Pêle-mêle, dans ce
fameux Tri Postal rénové en 2003, 40 ans d’art
contemporain et quelques clins d’œil jusqu’au XVIIIe
siècle, vus sur trois étages et sous trois angles :
« Les grands trans-parents », « Dommages
collatéraux » et « Life is a killer ». Avec
l’autruche du « pape » Maurizio Cattelan (pas de Nona
Ora dans la collection Collector…) en invitée
spéciale de l’affiche de l’exposition qui se tient
du 5 octobre au 1er janvier 2012, Collector balaie
références illustres du passé et icônes
déjà cultes ou en devenir de l’art contemporain :
Matisse, Ingres, Saura, Doisneau, Rauschenberg, Starck, Warhol, Ron
Arad, AES, matali crasset, Castelbajac…), la sélection
est éclectique et les images s’entrechoquent : la DS
coupée de Orozco répond à la Déesse de
Milo, le Néo-Codion de Baudevin ne nous soigne de rien, la
guerre de Wang Du guette, le rêve américain de Mounir
Fatmi s’effondre et celle d’AES se voile (triste
prémonition), les nombres d’Opalka s’alignent et
disparaissent jusqu'à la mort tout comme les crânes
de
Saâdane Afif tandis que l’horloge Real Time de
Maarten Baas compte le temps qui passe. Plombant ou vivifiant ? Qu'on
aime ou pas le climat rafraichissant et les rustiques fromages du Nord
de la France, Lille épate avec sa
programmation culturelle qui fait date, son habilité à
impliquer acteurs économiques et publics diversifiés, son
inventivité pour recycler piscine, centre postal, église
ou gare désaffectée en lieux d’art et autres
Maisons-Folies, sa vision « XXL » et festive de
l’art. Bombaysers de Lille… 3000 !
L’automne
arty ne serait pas ce qu’il est sans l’incontournable FIAC,
car c’est bien sur à Paris que cela se passe
côté business, marché et mondanités. Loin de
la crise ambiante paraît-il, et dans un grand écart entre
art moderne et art contemporain, la Foire Internationale d’Art
Contemporain 2011 avait cette année investi le prestigieux Grand
Palais mais s’égayait aussi dans les jardins des
Tuileries, où l’on retrouvait des œuvres de la
Biennale (océanique) d’Anglet et au Jardin des Plantes.
Les grands noms étaient tous là, des artistes (Cyndi
Sherman présente au Printemps de Septembre toulousain en 2005,
Soulages, Louise Bourgeois, Murakami, Xavier Veilhan, Buren, Gursky,
Lichtenstein, Damien Hirst…) aux galeristes de la place et
d’ailleurs en passant par quelques VIP. Avec 21 pays et 168
galeries représentés, 70 000 visiteurs, la FIAC 2011
signerait un grand succès qui placerait désormais Paris
juste derrière la grand-messe Art Basel. Vive la France !
Europe: Smart specialisation pour croissance durable
En direct de la Conférence "Regions for economic change", 23-24 Juin 2011, Bruxelles
Juin 2011
Smart specialisation ?
C’est
le tout nouveau, ou presque, concept en vogue à Bruxelles pour booster la
compétitivité et la croissance européennes.
L’idée : définir, et mettre en
place, une vision stratégique et intelligente du développement économique régional
basé sur une spécialisation territoriale sectorielle. Mais pas seulement :
il s’agit ici d’être spécialisé mais surtout pertinent et différenciant ! Halte
aux clusters à tout-va (on se souvient des quelques 2000 clusters répertoriés
en Europe à l’origine de la communication « Towards worldwide
clusters » de la Commission en 2008), et aux territoires tous désormais également
parsemés de « TIC Valley », « Bio Region »,
« Technoparc » et autres pôles de compétitivité qui manquent
d’excellence et regorgent de concurrence !
|
|

|
|
Dans
la « smart specialisation » que l’on
traduira au choix en français
par « élégant » ou
« intelligent », chaque région, au sens
européen du terme, est censée se focaliser sur son
« core business »,
savoir ce pour quoi elle est douée sur la base de son histoire,
de ses
compétences, de ses ressources, de son tissu économique,
de ses clusters
existants (on ne les oublie pas malgré tout) et
implémenter sur cette base une
politique régionale dédiée qui consiste ici
à accompagner les initiatives,
compétences et acteurs présents. Nouveauté de
l’exercice : on n’est ici ni
dans le « bottom-up », ni dans le
« top-down » mais dans
une juste synergie entre acteurs politiques, économiques,
académiques, universitaires,
car le tout s’intègre dans les stratégies
récemment dévoilées de l’Europe
« Innovation Union » et « Europe
2020 ». Autre fait
intéressant : on s’intéresse désormais
dès le départ à l’évaluation, au
suivi et à la vision stratégique… Sans oublier
d’ajouter une touche de vert,
« smart & green » étant les deux
facettes du développement
économique durable de demain… Et bien sûr une forte
dose d’esprit d’entreprise et
de vision entrepreneuriale.
Car,
lors de la conférence annuelle Regions for Economic Change qui se tenait à
Bruxelles du 23 au 24 juin sur le thème « Fostering smart and sustainable
growth in regions and cities », on a évoqué également quelques grandes
tendances qui changent la donne dans le monde de la politique économique :
si on a déjà beaucoup entendu parler de l’économie de la connaissance et des
compétences tout autant que de la régionalisation et de la montée en puissance
des métropoles au cœur même de la globalisation, quelques chiffres
interpellent : 99% des entreprises européennes sont des PME, 90% sont des
TPE, 32.5 millions de personnes, soit 20% de la population active, exercent en
libéral. Et 23 millions de personnes sont de « purs » freelance. De
ce constat et de ces nouveaux modes de travailler, naît une « économie de
projet » basée sur un véritable esprit d’entreprise et où les équipes
ad-hoc se constituent de façon flexible et ciblée pour mener à bien un projet
donné. Ce qu’Ann Mettler, CEO du Lisbon Council, appelle le « Hollywood
model », à l’image de ce qui se fait lors du tournage d’un film.
La
croissance sera donc désormais glamour, élégante et intelligente. So
smart !
|
|
|
|
|